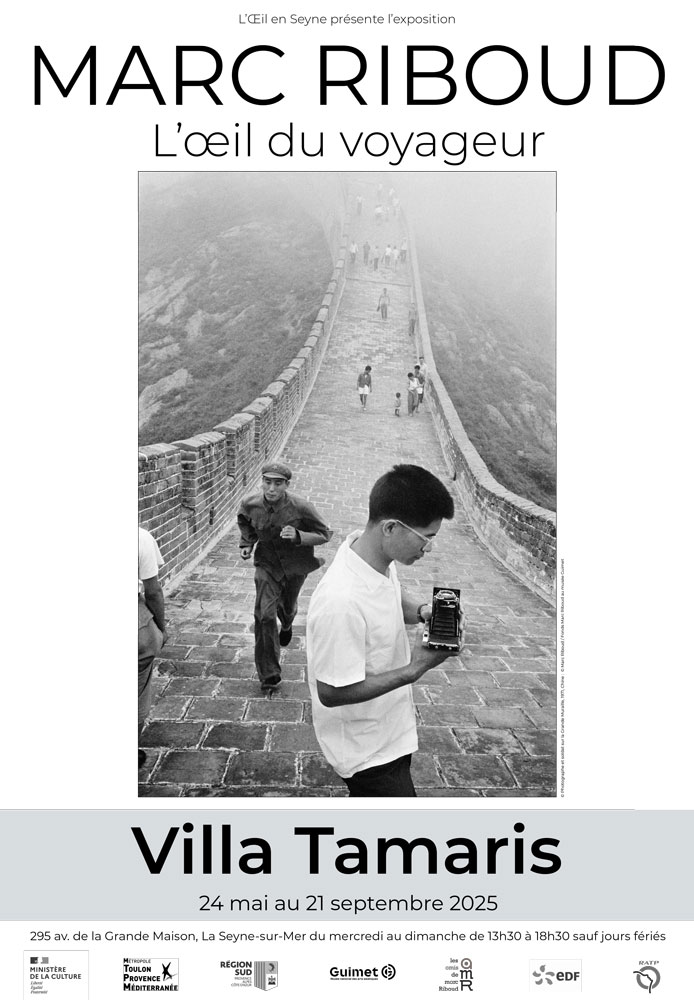Alain Dupuis, chez lui. Ancien directeur commercial de Sygma, ancien « vendeur » de l’agence Apis. (c) Michel Puech / www.puech.info
Pendant 40 ans, à pied, en mobylette puis en Vespa, Alain Dupuis fut à Paris le roi des vendeurs de photos de presse. L’homme, qui de 1973 à 2000, a fait la bonne fortune des photographes et celle de l’agence Sygma. Un mythe, le témoin de ce fameux « âge d’or » du photojournalisme.
 Article publié le 25 aout 2011 dans La lettre de la photographie
Article publié le 25 aout 2011 dans La lettre de la photographie
« J’ai vraiment pris mon pied dans ce boulot, malgré la fatigue et ses conséquences sur ma santé. Mais je gagnais très bien ma vie et j’ai rencontré de vrais professionnels et surtout un très grand bonhomme, Hubert Henrotte. » Assis dans le canapé du bureau de sa compagne Dominique Martel, ancienne responsable des ventes internationales à Corbis-Sygma, Alain Dupuis a accepté de raconter en exclusivité « son époque ». « Depuis dix ans, Dominique et moi, nous avons perdu de vue le métier et nous parlons rarement de Sygma. »
L’homme est calme, tranquille, serein quand il fait visiter son jardin. Il a pris un peu de poids suite à des problèmes de santé. Comme d’autres, lorsque le rythme épuisant des agences de news s’arrête, apparaissent les problèmes. « J’ai craqué… Je me baladais au bois de Vincennes comme un retraité… Je me suis retrouvé à l’hopital. »
Aujourd’hui, dans leur charmante petite ferme arrangée avec goût, Dominique et Alain sont occupés par leurs petits-enfants, le jardin, la lecture etc. Pourtant à la gare de Saumur où il est venu me chercher, dès que nous nous sommes reconnus, après m’avoir demandé des nouvelles de son ancien patron, il me dit : « T’as vu, c’est encore Monique Kouznetzoff qui a fait la couv de Paris Match ! » Comme quoi le père tranquille à toujours l’œil.
Comment as-tu débuté dans ce métier très particulier de la vente de droits de reproductions de photographie de presse ?
En 1962, vendeur d’agence, c’est un métier qui n’existait pas. Quand je suis revenu du service militaire – c’était la guerre en Algérie – j’ai passé une petite annonce : « JH dégagé des obligations militaires, ch emploi commercial ». J’ai reçu quarante-deux propositions ! Les temps ont bien changé… Mon beau-père m’a dit vas là.
Là, c’était l’agence APIS que François Grenier, un ancien de France-Soir venait de créer rue de Trévise, près des grands boulevards parisiens. Je suis allé me présenter et le lendemain je travaillais.
A APIS, il y avait des photographes comme Jean Ker, Pierre Bernarsconi, Henri Bureau… Ils ont eu la gentillesse de m’accompagner dans les rédactions. Il fallait montrer le gamin. Certains d’entre eux m’ont même emmené en reportage pour que je comprenne leur métier.
Quels sont les journaux que tu visitais à l’époque ?
J’étais le seul commercial, donc je faisais tout ce que je pouvais. Je partais le matin avec un maximum de dix reportages et un jeu de tirages NB pour chaque. Je commençais par le Sentier, qui était alors le quartier de la presse. Rue Réaumur, dans le même immeuble, il y avait France-Soir, Paris-Presse, l’Intransigeant, France-Dimanche, Elle, le Daily Mirror. Deux cent mètres plus loin, il y avait Paris-Jour que venait de créer Madame Del Ducca et le Parisien Libéré…
A France-Soir, qui te recevait : Pierre Lazareff?
Pierre Lazareff, je le voyais de temps en temps. Il avait un responsable photo pour les achats courants. Par contre à Elle, je montrais les photos à Hélène Lazareff. La concurrence, c’était les représentants d’UPI, d’AP… Je les regardais avec des grands yeux. Ils vendaient des « belins » (ndlr : de la technique du bélinographe) qui arrivaient directement dans les rédactions, une heure ou deux après la prise de vue ! Eux, ils passaient ensuite avec des carnets à en-tête de l’agence pour faire la facture. C’était très cher. Ils comptaient les frais de transmission, plus le droit de reproduction.
Du coup, j’ai dit à mon patron que pour nos « agence feature », c’est comme cela que nous les appelions à l’époque, il nous fallait aussi des carnets imprimés. J’allais à Paris Presse, je vendais une photo 80 francs et le rédacteur en chef signait. Tous les soirs, je donnais les doubles à la comptabilité. Ce système s’est généralisé à toutes les agences et a perduré longtemps.
Quelles étaient les autres « agences feature »?
AGIP, Reporters Associés… Quelques indépendants qui faisaient du « charme » comme Giancarlo Botti… Notre vraie concurrence, à cette époque, c’était les photographes salariés des journaux. Il y avait non seulement des services photos mais des photographes attachés au journal.
Quand mon patron a vu que je me débrouillais bien, il m’a acheté une mobylette Peugeot bleue. Elle m’a permis d’aller plus vite que la concurrence aux Champs Elysées où se trouvaient les rédactions des magazines comme Paris Match, Marie-Claire, Jour de France… C’est aux Champs Elysées que se sont ouverts les bureaux des journaux allemands comme Stern, Quick puis tout le groupe Burda avec lequel nous avons tellement tra vaillé et fait la fiesta. Il y avait aussi L’Express, le Nouvel Observateur et « la presse à scandale » (Ici Paris, Détective, etc.). J’ai fait mon trou chez APIS.
La création de Gamma en 1967 a tout de suite compté sur le marché ?
Mon patron, Jean Grenier, était un vrai journaliste, mais ce n’était pas un homme d’affaires. Il s’intéressait beaucoup au cinéma. Alors Henri Bureau « planquait » Brigitte Bardot, Liz Taylor et Richard Burton, la Callas… Ces gens se vendaient très bien. Le marché était déjà là. Mais la création de Gamma, ça a été l’assommoir !
Ils sont arrivés avec des moyens, des laboratoires, des grands locaux à côté des Champs Elysées… Ils envoyaient des photographes partout avec des correspondants dans tous les coins de la planète : la méthode Henrotte quoi !
Celle qu’il va appliquer à Sygma ?
Exact. Au moment de la scission chez Gamma en 1973, Hubert Henrotte achète APIS, les photographes, les archives, tout… J’étais très content de travailler avec cette équipe. On s’est donc tous retrouvés rue Réaumur dans les locaux d’APIS : une entrée, un laboratoire, deux petits bureaux, un pour la comptabilité, l’autre pour Henrotte, et dans le couloir une glaceuse rotative et les archives des tirages photos…
Les premiers mois Henri Bureau a obtenu un rendez-vous chez les Pompidou. Alain Nogues a « couvert » la sécheresse dans le Sahel. Il y avait aussi comme photographes Alain Dejean, Christian Simonpietri et d’autres… J’en oublie évidemment. Mais leurs reportages se sont tout de suite bien vendus. Nous avions quand même Gamma en face… Mais ils étaient un peu déstabilisés…
Jean Monteux, qui avait été vendeur aux Reporters Associés, était à Gamma, comment cela se passait-il entre vous ?
Normal. On se serrait la main. Moi, je n’ai jamais eu de problème avec Monteux, même si lui en avait peut-être avec ses anciens associés. Pas de coups bas entre nous. On se parlait du métier. Evidemment il fallait rester discret. Je le rencontrais dans la tournée des rédactions. On se tirait la bourre aux feux rouges, ce n’est pas une légende. A Sygma j’étais salarié, mais nous étions quand même tous au pourcentage des ventes… Cela dit, nous ne pensions pas qu’à l’argent. Gamma voulait se maintenir, et nous à Sygma il nous fallait grimper, grimper, s’imposer. Il y avait l’orgueil de la réputation de l’agence quand même !
ll fallait arriver le premier dans les journaux, car les journaux n’achetaient pas deux fois le même sujet . André Lacaze, premier responsable de la photo de Paris Match que j’ai connu, m’a appris mon métier, puis il y a eu Walter Carone, Bernard Brick, Michel Sola n’était pas encore à l’achat mais à l’editing des photos avec Didier Rapaud. C’est plus tard que Paris Match achètera deux, trois fois le même sujet pour bloquer la concurrence.
En 1973, 74, 75 quels étaient les prix des photos ?
Il y avait des tarifs par page. La page était à 500 francs, puis à 750. On arrivait par exemple à Paris Match et on demandait une garantie pour une ou deux pages … Quand il y avait des coups, on essayait de monter les prix, mais c’était difficile, il n’y avait pas beaucoup de concurrence. L’Express se bagarrait encore un petit peu pour acheter des sujets. France Dimanche se bagarrait beaucoup plus. Il se battait contre Paris Match sur des évènements comme la mort d’Edith Piaf, le couronnement de l’impératrice d’Iran. Là, il était capable d’investir, mais c’était exceptionnel. On ne pouvait pas rouler des mécaniques.
Rien à voir avec les années 80/90 celles de la « yellow press » quand Axel Ganz est arrivé et a commencé à créer Voici puis Gala….
Mais avant l’arrivée d’Axel Ganz à Paris, il y a eu la création de VSD !
L’arrivée du Vendredi Samedi Dimanche de Maurice Siegel a considérablement relancé le marché… La publicité de VSD c’était ce que vous ne verrez pas ailleurs ! Donc il fallait chaque semaine qu’il se procure des coups.
De temps en temps, j’avais des ordres de ma direction pour laisser filer des reportages et aider VSD. On ne pouvait pas mettre toutes les billes de l’agence dans le même journal. C’était Claude Duverger qui s’en occupait. Il avait longtemps travaillé pour Maurice Siegel à Europe 1. Entre Claude et moi, il y a eu quelques frictions, mais c’était commercial, car nous nous sommes toujours bien entendus.
A ce moment là, les enchères ont commencé entre VSD et Paris Match, non ?
Ah oui ! La les enchères montaient au téléphone. Je ne parlerai pas de prix car je risquerai de dire des bêtises car c’est loin tout ça… Et puis, je n’ai jamais parlé d’argent. Mais oui, il y a eu des fois où VSD a mis plus sur la table que Paris Match. Au début de VSD, Paris Match a été gêné. Et puis il y a eu une période où Paris Match a fini par snober VSD… C’était des seigneurs à Paris Match !
Tu te souviens de certaines enchères?
Oui, il y en a une qui me revient… Je crois que l’agence avait un reportage exceptionnel sur l’attentat du Drackkar à Beyrouth (ndlr : où 58 soldats français sont morts). On avait une photo d’un secouriste avec un très beau geste vers un soldat. Je crois bien qu’il y avait eu une « grimpette ». La « grimpette » c’était l’expression inventée par Michel Sola. Tous les vendeurs connaissent la « grimpette » ! Claude Duverger et moi, nous montrions en même temps les photos dans les rédactions. On sortait du service photo et on s’appelait. Je retournais dans le bureau de Michel Sola en disant « VSD met tant ». Soit il disait un chiffre supérieur, soit il mettait le pouce en bas.
Hubert Henrotte a eu une politique très intelligente vis-à-vis de Maurice Siegel qui était un monument du journalisme… Donc de temps en temps on a vendu volontairement à VSD. Il faut dire qu’il nous passait aussi beaucoup de commandes.
Pour l’anecdote, quand Claude Duverger partait en vacances, je le remplacais à VSD et ce n’était pas facile car j’étais « l’homme de Match ». Une fois Maurice Siegel très en colère m’a demandé de sortir !
Et plus tard, dans les années 80/90, comment les prix ont-ils continué de monter ?
C’est l’arrivée de la presse à scandale qui a changé la donne… A Sygma nous ne faisions pas de planque, pas de paparazzi. Mais la « pipolisation » à outrance a fait grimper les prix avec l’arrivée sur le marché de tous ces couples, de tous ces gens « bancable » et puis surtout, la création de Gala.
Avant, avec la famille de Monaco, c’était des rendez-vous organisés par Sygma. Des séances photo de prestige dont la publication était convenue à l’avance avec les Grimaldi donc pas de « grimpette ». Et puis, le département « people charme » était dirigé de main de maître par Monique Koutnezoff. Monique ne voulait pas retrouver un portrait d’Isabelle Adjani ou de Catherine Deneuve dans un journal comme Voici qui allait écrire n’importe quoi en légende, alors que les photos avaient été faites chez les stars, avec leur autorisation.
La grande période de Sygma commence avec Diana. Le marché sur Diana et Charles était dans les mains d’un photographe anglais Tim Graham qui avait ses entrées à la cour. Il suivait tous les voyages du couple. Alors là les prix ont commencé à vraiment monter car, contrairement à la famille Grimaldi, nous pouvions vendre à tout le monde.
Quels sont les sujets, les photographes qui faisaient de bonnes ventes ?
Les faits divers, l’affaire du petit Grégory couverte par Philippe Ledru a fait beaucoup de ventes… Et puis il ne faut pas oublier un personnage extraordinaire, James Andanson qui est devenu le photographe de Monsieur Gabin, de Bérégovoy, de Pasqua… Peu importe les recettes, peu importe comment il approchait ces gens là, mais il rapportait. Il a rapporté beaucoup d’argent à l’agence et aux vendeurs.
Pour revenir au marché, il y a tout un moment où il y a des tarifs, puis arrive la « grimpette » entre VSD et Paris Match, puis la « pipolisation »…
Et après c’est nous qui fixions les prix. Ma réputation de bon vendeur est due à la qualité du matériel que j’avais en partant de l’agence le matin. Mais quand je montais sur ma Vespa, je n’avais pas de prix de vente en tête. Je savais par contre ce qu’avait coûté le reportage, les risques pris par le photographe, les coûts des voyages, du laboratoire… Je savais qu’il fallait que je tape haut, mais je n’avais pas de prix fixé.
J’arrivais dans un journal, j’attendais comme tous les autres vendeurs d’agence, et quand j’étais face au rédacteur en chef, je ne parlais pas d’argent. Je discutais de nos vies, qu’est- ce que tu as fait ce week-end, etc… Petit à petit, je sortais mes photos, je regardais l’homme qui regardait le sujet et je proposais au rédacteur en chef une façon d’exploiter les photos, au lieu de faire quatre pages comme ça, tu pourrais en faire huit avec un complément…. J’étais très apprécié pour ma capacité à donner des idées.
Avec Michel Sola à Paris Match, c’était un véritable échange. Il me disait : « mon petit Alain si on ne raconte pas une histoire, tu repars avec tes photos. » Et tout était là. Le photographe avait fait le reportage, derrière, l’éditeur avait fait une sélection, mais ensuite on devait resserrer tout ça dans un nombre de pages déterminé. A un moment je sentais qu’il mordait. Il me demandait de sortir pour téléphoner à Roger Thérond. Quand je revenais dans le bureau, je fixais un prix et on discutait.
A partir du moment où la « grimpette » est devenue une habitude, nous avons commencé à jouer les voyous. On vendait aux enchères des reportages qui ne le méritaient pas, à des prix fous.
Je me souviens de la fille de Mitterrand… Je me souviens quand j’ai vendu cette photo à Paris Match… Tout ça s’est emballé ! Mais ça marchait.
Même le news, la photo de guerre ?
Le news… Je crois me souvenir qu’il y a eu une « grimpette » sur la guerre des Malouines. La place Tien’anmen, je ne crois pas mais c’est mal tombé pour les bouclages. La Pologne, Henri Bureau a photographié les chars soviétiques, c’était un coup exceptionnel…
Ce n’était pas une commande ?
Je ne crois pas… IL faudrait demander à Henri Bureau s’il s’en souvient. A ce moment l’agence avait des problèmes financiers, nous avions donc instruction de prendre des garanties. La Pologne, c’était peut-être un « assigment » de Newsweek ou bien une commande de Paris Match. C’est possible. Avec les commandes c’est plus difficile de monter le prix, mais à Paris Match ils ont toujours su se tenir.
Pour la place Tien’anmen je me souviens que Paris Match avait doublé la garantie après publication car il avait le respect du grand reporter. Ils ont toujours aimé « les plaques »…
A un moment j’avais sept vendeurs sous mes ordres. Nous partions tous avec les même sujets… Le début des années 90 c’est une époque qui m’a beaucoup fatigué. J’arrivais chez Michel Sola à Paris Match. Il regardait les planches de diapos face à sa fenêtre en tournant son fauteuil et il sortait des photos pour monter une histoire. Quand il avait fini il me demandait combien… Et là, ça la foutait mal, je devais lui dire que Claude Duverger était à VSD avec les mêmes images… Il s’énervait. Ils se sont tous énervés. Le climat a commencé à se détériorer. Les rédacteurs en chef me le disaient, profitez en ça ne va pas durer. Ils le savaient au vu des courbes de ventes du journal. Ils mettaient de l’argent et ça ne faisait pas vendre.
C’est sûr que dans mes dernières années de vente, avant l’an 2000, les photographes de news étaient déjà très angoissés. D’abord les rédactions me disaient, Alain tu sais bien que ça ne fait pas vendre.
Quand as-tu vu revenir en force la concurrence des agences dites télégraphiques ?
Ils ont commencé à transmettre comme des dingues dès qu’il y a eu le numérique. Je le disais à Hubert Henrotte … J’ai senti venir la fin…. Durant la guerre du Golfe, Sygma fait la première transmission de photos numériques pour les agences feature mais les télégraphistes faisaient ça depuis longtemps.
A la fin des années 90, tu es directeur commercial avec combien de vendeurs ?
Quand les américains sont arrivés, j’ai demandé à partir. Ils m’ont demandé de rester.
J’avais six gars .. On avait chacun notre titre. .. C’était l’usine. C’était la folie, le soir je rentrais à l’agence il y avait des tirages partout. J’avais 300 tirages par jour, ça dégueulait dans les couloirs des journaux et des agences… Henrotte ça le minait de voir ces piles d’invendus.
Le travail est devenu sans intérêt car il y avait des dégueulis de tirages… Et puis arrive un moment où tu ne sais plus ce que tu fais…
Le climat s’était-il dégradé à la fin des années 90 ?
Le climat n’était pas dégradé mais il y avait une inquiétude. Quand le dernier actionnaire avant les américains est arrivé, il y a eu des bruits de vente, mais on continuait à bosser.
Comment ça s’est passé quand Hubert Henrotte a été licencié ?
Il a été mis à l’écart d’une façon très curieuse. Un jour nous avons trouvé Monsieur Smadja à sa place, dans son bureau et Hubert Henrotte nous a laissé une lettre.A l’époque, j’étais en froid avec lui à cause d’Andanson. James m’a reproché de ne pas avoir vendu un truc à lui et Henrotte a dit que c’était de ma faute. Mais quand Hubert a été dans cette position, je lui ai dit que je voulais partir et il m’a répondu Sygma sans vous ce n’est pas possible. Mais bon, je ne lui en veux pas, il était fatigué. Il disait vous ne m’aimez pas ! Cela nous a fait beaucoup de peine quand il est parti. Il nous a toujours payé avant la fin de chaque mois et parfois ce n’était pas facile. Il s’est défoncé toute sa vie pour l’agence Sygma, pour le photojournalisme.
Et l’arrivée des américains ça s’est passé comment ?
Quand j’ai su qu’ils arrivaient, j’ai demandé à partir. J’étais à l’age de la retraite. Un jour il y en un qui nous a tous réunis, il est monté sur un escabeau et il a dit qu’on allait travailler ensemble. Mais petit à petit tout le monde a bien compris qu’on ne travaillerait pas vraiment ensemble.
Propos recueillis par Michel PuechDernière révision le 3 mars 2024 à 7:19 pm GMT+0100 par Michel Puech
Et pour ne rien louper, abonnez vous à 'DREDI notre lettre du vendredi